La dépendance au numérique est d’actualité. On en parle beaucoup au Québec, relativement à l’usage des téléphones intelligents chez les jeunes en milieu scolaire. Une nouvelle étude vient d’être publiée sur les effets d’Internet sur le cerveau des jeunes. Pas joyeux. Les usages du numérique, gavés par l’IA, vont croître rapidement, permettant des gains de productivité personnels et corporatifs, ainsi qu’une bonification sensible des expériences offertes – immersives et hybrides, – souvent appliquées au tourisme.
Mais quels sont les effets sur notre santé mentale, nos relations sociales et notre bonheur réel? Peut-on et doit-on, comme travailleur en tourisme ou comme voyageur, prétendre mieux gérer l’hyperconnectivité ou même carrément se déconnecter? Entrevue avec une des rares spécialistes dans ce nouveau champ d’intérêt, Laurie Michel, déjà impliquée dans le tourisme au Québec.

1. Qui êtes-vous et que faites-vous?
Je suis née à Montréal, mais j’ai grandi à Toulouse. En France, la compétition chevaline était ma passion (ndlr: elle a concouru en compétition internationale en France!). Sinon, j’ai été formée en normes ISO (amélioration continue et certification marque NF).
Depuis 2014, de retour à Montréal pour la langue française d’une grande ville nord-américaine. Je suis arrivée, je crois, avec la bonne attitude de curiosité, de voir, d’apprendre et je souhaitais m’intégrer rapidement. Au début, j’œuvrais en marketing numérique (loisir, tourisme, agences Web, produits alimentaires) et je suis devenue accro de mon téléphone, ce qui m’amena des problèmes de santé, car ça brouillait mon sommeil, mes relations sociales.
Cette hyperconnectivé m’a presque amenée à un burn-out… C’est aussi sociétal, on le sait. On le voit bien aujourd’hui, avec les jeunes et la santé mentale. Mais ce n’est pas la techno le problème, c’est la façon de l’utiliser. Je ne suis pas antitechno, il faut le dire. Bref, après cette étape de ma vie, j’ai développé, avec une psychologue clinicienne et de multiples ressources, une approche pour mieux gérer l’hyperconnectivité, moi étant le cobaye au départ. À partir de là, j’ai voulu devenir une ambassadrice de saines habitudes numériques…
Ma compagnie Vivala a été créée en 2019, une firme spécialisée dans le bien-être numérique et dans l’aide à la déconnexion. Vivala: la vie se passe à l’extérieur des écrans! Vivala Vida, Vivala off-line… Cette entreprise, c’est une véritable mission, une passion de vie.
En août 2021, j’ai publié un livre: «Moins d’écrans, plus de moments présents», qui propose un accompagnement de 30 jours pour adopter de saines habitudes numériques.
2. Vos objectifs?
Éduquer sur l’hyperconnectivité, sur la santé mentale et physique, les relations sociales, la concentration, la capacité d’attention, la productivité. Parler des bénéfices de la déconnexion. Je pense que c’est essentiel pour toute organisation, dans un contexte de rareté des ressources humaines. Nous sommes dans le «bien-être», la santé mentale, la santé durable. Et nous sommes dans un monde de «To Do», de livrables. Il n’y a pas vraiment de différences entre les générations, c’est plus selon la personnalité de chacun(e). Ah si, une différence générationnelle, tout de même, pour les 18 à 35 ans: la «téléphonophobie», cette peur de l’instantanéité qu’un simple appel téléphonique apporte, de la conversation directe, car on ne contrôle alors pas tout. Contrairement à une participation avec de multiples participants sur Teams ou Zoom…
Bref, nous offrons des conseils, peu importe le secteur d’activités, pour une meilleure utilisation des technologies. Nous offrons des conférences, des formations, de la teambuilding, jusqu’à un accompagnement complet d’un an, selon les besoins.
Dernièrement, nous avons lancé un projet réservé au domaine du tourisme, un label pour protéger les lieux de repos vis-à-vis de la déconnexion numérique. Nous avons créé 3 niveaux de label pour toute organisation avec audit complet au départ, et ensuite de la formation des équipes et un accompagnement. Comme ISO, nous sommes ici dans l’amélioration continue.
3. Comment appliquer la déconnexion au tourisme? Pour le personnel de l’organisation et/ou les visiteurs en priorité?
Les centres de villégiature ont un rôle à jouer dans la déconnexion. Ils sont vus par leurs clients comme des centres de vacances, de ressourcement pour lâcher prise avec ses responsabilités professionnelles et numériques… Souvent, on parle de «digital detox», des sevrages drastiques, mais ça c’est une mode qui peut ne pas fonctionner pour tout le monde! Vivala, au contraire, se positionne avec une expertise sur la gestion de la technodépendance. Il faut que la déconnexion soit durable. Quand on voit des personnes dans des spas avec leur téléphone dans les bains, la difficulté de la déconnexion est évidente.
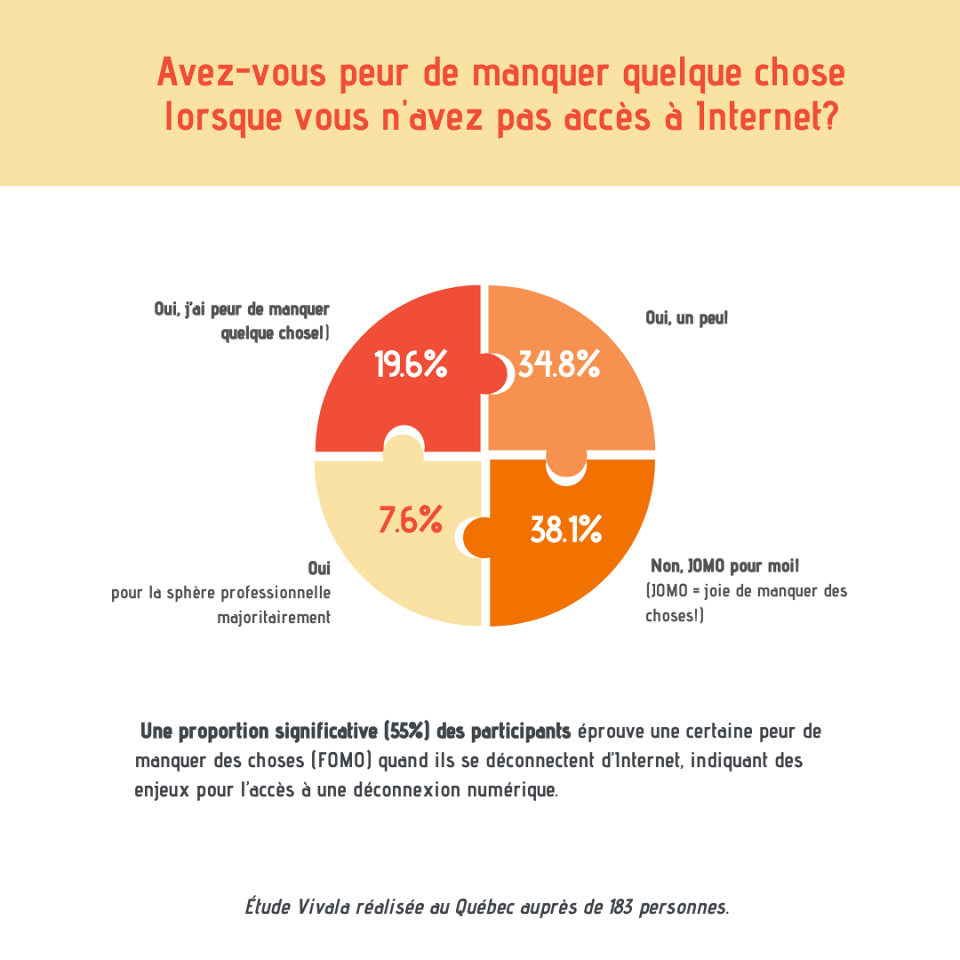
4. La majorité des touristes veulent rester branchés lorsqu’ils voyagent. La déconnexion n’est-elle pas, alors, un marché de niche?
On va évaluer éventuellement ce que souhaitent réellement les voyageurs, car il y a aussi une tendance à se débrancher des réseaux sociaux. Il y a de la sensibilisation à faire. Un jour pas si lointain, il y aura une demande forte vers ce type de conseils auprès des voyageurs. La question: est-ce que les PMEs touristiques veulent s’engager sur cet enjeu sociétal majeur? La déconnexion, c’est comme l’écologie dans 20 ans: ce sera une évidence.
5. Quelles sont les meilleures pratiques actuelles appliquées au tourisme?
 Formation à l’hyperconnectivité et à la déconnexion numérique d’une partie de l’équipe du Manoir Youville et remise du label Vivala – Aide à la déconnexion niveau découverte
Formation à l’hyperconnectivité et à la déconnexion numérique d’une partie de l’équipe du Manoir Youville et remise du label Vivala – Aide à la déconnexion niveau découverte
Nous mettons en place des formations et des outils pour les équipes internes de l’entreprise et pour la gestion individuelle. Par exemple, comment je gère un client qui ne veut pas lâcher son téléphone dans le spa…Notez que le tourisme est déjà beaucoup numérisé (ex.: réservation). Se déconnecter ne veut pas dire qu’on exclue la techno dans ses opérations. On parle de soutenir la déconnexion des clients et si, en même temps, on peut éveiller les consciences côté employés, c’est super, parce que nous sommes tous dans la même équipe face à l’hyperconnectivité!
Voyez les détails sur notre site Web, avec deux exemples concrets: le Manoir D’Youville en Montérégie et le Centre de l’Hêtre dans la région de Québec.
___________________________
Je retiens que tout est une question d’équilibre. Avec l’accélération du numérique dans nos vies et dans nos voyages, il faut réfléchir – pour bien répondre aux attentes de visiteurs – comment on peut leur offrir dans le temps (100% du temps de leur séjour?) et dans l’espace (partout sur le site d’hébergement ou d’activité?) une déconnexion au numérique et une connexion à eux-mêmes, aux autres et à l’environnement naturel.
JEAN-MICHEL PERRON

Commentaires
Publier un commentaire